CONTE : ZADIG, ou la destinée - Partie 2
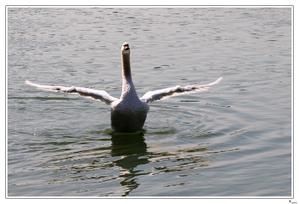
LES DISPUTES ET LES AUDIENCES
C’est ainsi qu’il montrait tous les jours la subtilité de son génie et la bonté de son âme ; on l’admirait, et cependant on l’aimait. Il passait pour le plus fortuné de tous les hommes, tout l’empire était rempli de son nom ; toutes les femmes le lorgnaient ; tous les citoyens célébraient sa justice ; les savants le regardaient comme leur oracle ; les prêtres même avouaient qu’il en savait plus que le vieux archimage Yébor. On était bien loin alors de lui faire des procès sur les griffons ; on ne croyait que ce qui lui semblait croyable.
Il y avait une grande querelle dans Babylone, qui durait depuis quinze cents années, et qui partageait l’empire en deux sectes opiniâtres : l’une prétendait qu’il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mithra que du pied gauche ; l’autre avait cette coutume en abomination, et n’entrait jamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig. L’univers avait les yeux sur ses deux pieds, et toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds joints, et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre, qui n’a acceptation de personne, ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite.
L’envieux et sa femme prétendirent que dans son discours il n’y avait pas assez de figures, qu’il n’avait pas fait assez danser les montagnes et les collines. « Il est sec et sans génie, disaient-ils ; on ne voit chez lui ni la mer s’enfuir, ni les étoiles tomber, ni le soleil se fondre comme de la cire : il n’a point le bon style oriental. » Zadig se contentait d’avoir le style de la raison. Tout le monde fut pour lui, non pas parce qu’il était dans le bon chemin, non pas parce qu’il était raisonnable, non pas parce qu’il était aimable, mais parce qu’il était premier vizir.
Il termina aussi heureusement le grand procès entre les mages blancs et les mages noirs. Les blancs soutenaient que c’était une impiété de se tourner, en priant Dieu, vers l’orient d’hiver ; les noirs assuraient que Dieu avait en horreur les prières des hommes qui se tournaient vers le couchant d’été. Zadig ordonna qu’on ne tournât comme on voudrait.
Il trouva ainsi le secret d’expédier, le matin, les affaires particulières et les générales ; le reste du jour, il s’occupait des embellissements de Babylone : il faisait représenter des tragédies où l’on pleurait, et des comédies où l’on riait, ce qui était passé de mode depuis longtemps, et ce qu’il fit renaître parce qu’il avait du goût. Il ne prétendait pas en savoir plus que les artistes ; il les récompensait par des bienfaits et des distinctions, et n’était point jaloux en secret de leurs talents. Le soir, il amusait beaucoup le roi, et surtout la reine. Le roi disait : « Le grand ministre ! » La reine disait : « L’aimable ministre ! » et tous deux ajoutaient : « C’eût été grand dommage qu’il eût été pendu. »
Jamais homme en place ne fut obligé de donner tant d’audience aux dames. La plupart venaient lui parler des affaires qu’elles n’avaient point, pour en avoir une avec lui. La femme de l’envieux s’y présenta des premières ; elle lui jura par Mithra, par Zenda-Vesta, et par le feu sacré, qu’elle avait détesté la conduite de son mari ; elle lui confia ensuite que ce mari était un jaloux, un brutal ; elle lui fit entendre que les dieux le punissaient en lui refusant les précieux effets de ce feu sacré par lequel seul l’homme est semblable aux immortels : elle finit par laisser tomber sa jarretière ; Zadig la ramassa avec sa politesse ordinaire ; mais il ne la rattacha point au genou de la dame ; et cette petite faute, si c’en est une, fut la cause des plus horribles infortunes. Zadig n’y pensa pas, et la femme de l’envieux y pensa beaucoup.
D’autres dames se présentaient tous les jours. Les annales secrètes de Babylone prétendent qu’il succomba une fois, mais qu’il fut tout étonné de jouir sans volupté, et d’embrasser son amante avec distraction. Celle à qui il donna, sans presque s’en apercevoir, des marques de sa protection, était une femme de chambre de la reine Astarté. Cette tendre Babylonienne se disait à elle-même pour se consoler : « Il faut que cet homme-là ait prodigieusement d’affaires dans la tête, puisqu’il y songe encore même en faisant l’amour. » Il échappa à Zadig, dans les instants où plusieurs personnes ne disent mot, et où d’autres ne prononcent que des paroles sacrées, de s’écrier tout d’un coup : « La reine ! » La Babylonienne crut qu’enfin il était revenu à lui dans un bon moment, et qu’il lui disait : « Ma reine ! » Mais Zadig, toujours très distrait, prononça le nom d’Astarté. La dame, qui dans ces heureuses circonstances interprétait tout à son avantage, s’imagina que cela voulait dire : « Vous êtes plus belle que la reine Astarté. » Elle sortit du sérail de Zadig avec de très beaux présents. Elle alla conter son aventure à l’envieuse, qui était son amie intime ; celle-ci fut cruellement piquée de la préférence. « Il n’a pas daigné seulement, dit-elle, me rattacher cette jarretière que voici, et dont je ne veux plus me servir. −Oh ! oh ! dit la fortunée à l’envieuse, vous portez les mêmes jarretières que la reine ! Vous les prenez donc chez la même faiseuse ? » L’envieuse rêva profondément, ne répondit rien et alla consulter son mari l’envieux.
Cependant Zadig s’apercevait qu’il avait toujours des distractions quand il donnait des audiences et quand il jugeait ; il ne savait à quoi les attribuer : c’était là sa seule peine.
Il eut un songe : il lui semblait qu’il était couché d’abord sur des herbes sèches, parmi lesquelles il y en avait quelques-unes de piquantes qui l’incommodaient ; et qu’ensuite il reposait mollement sur un lit de roses, dont il sortait un serpent qui le blessait au cœur de sa langue acérée et envenimée. « Hélas ! disait-il, j’ai été longtemps couché sur ces herbes sèches et piquantes, je suis maintenant sur le lit de roses, mais quel sera le serpent ? »

LA JALOUSIE
Le malheur de Zadig vint de son bonheur même, et surtout de son mérite. Il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté, son auguste épouse. Les charmes de sa conversation redoublaient encore par cette envie de plaire qui est à l’esprit ce que la parure est à la beauté ; sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s’aperçut pas d’abord. Sa passion croissait dans le sein de l’innocence. Astarté se livrait sans scrupule et sans crainte au plaisir de voir et d’entendre un homme cher à son époux et à l’Etat ; elle ne cessait de le vanter au roi ; elle en parlait à ses femmes, qui enchérissaient encore sur ses louanges ; tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu’elle ne sentait pas. Elle faisait des présents à Zadig, dans lesquels il entrait plus de galanterie qu’elle ne pensait ; elle croyait ne lui parler qu’en reine contente de ses services, et quelquefois ses expressions étaient d’une femme sensible.
Astarté était beaucoup plus belle que cette Sémire qui haïssait tant les borgnes, et que cette autre femme qui avait voulu couper le nez à son époux. La familiarité d’Astarté, ses discours tendres, dont elle commençait à rougir, ses regards, qu’elle voulait détourner, et qui se fixaient sur les siens, allumèrent dans le cœur de Zadig un feu dont il s’étonna. Il combattit ; il appela à son secours la philosophie, qui l’avait toujours secouru ; il n’en tira que des lumières, et n’en reçut aucun soulagement. Le devoir, la reconnaissance, la majesté souveraine violée, se présentaient à ses yeux comme des dieux vengeurs ; il combattit, il triomphait ; mais cette victoire, qu’il fallait remporter à tout moment, lui coûtait des gémissements et des larmes. Il n’osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charmes pour tous deux : ses yeux se couvraient d’un nuage ; ses discours étaient contraints et sans suite : il baissait la vue ; et quand, malgré lui, ses regards se tournaient vers Astarté, ils rencontraient ceux de la reine mouillés de pleurs, dont il partait des traits de flamme ; ils semblaient se dire l’un à l’autre : « Nous nous adorons, et nous craignons de nous aimer ; nous brûlons tous deux d’un feu que nous condamnons. »
Zadig sortait d’auprès d’elle égaré, éperdu, le cœur surchargé d’un fardeau qu’il ne pouvait plus porter : dans la violence de ses agitations, il laissa pénétrer son secret à son ami Cador, comme un homme qui, ayant soutenu longtemps les atteintes d’une vive douleur, fait enfin connaître son mal par un cri qu’un redoublement aigu lui arrache, et par la sueur froide qui coule sur son front.
Cador lui dit : « J’ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même ; les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre. Jugez, mon cher Zadig, puisque j’ai lu dans votre cœur, si le roi n’y découvrira pas un sentiment qui l’offense. Il n’a d’autre défaut que celui d’être le plus jaloux des hommes. Vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne, parce que vous êtes philosophe, et parce que vous êtes Zadig. Astarté est femme ; elle laisse parler ses regards avec d’autant plus d’imprudence qu’elle ne se croit pas encore coupable. Malheureusement, rassurée sur son innocence, elle néglige des dehors nécessaires. Je tremblerai pour elle tant qu’elle n’aura rien à se reprocher. Si vous étiez d’accord l’un et l’autre, vous sauriez tromper tous les yeux : une passion naissante et combattue éclate ; un amour satisfait sait se cacher. » Zadig frémit à la proposition de trahir le roi, son bienfaiteur ; et jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d’un crime involontaire. Cependant la reine prononçait si souvent le nom de Zadig, son front se couvrait de tant de rougeur en le prononçant, elle était tantôt si animée, tantôt si interdite, quand elle lui parlait en présence du roi ; une rêverie si profonde s’emparait d’elle quand il était sorti, que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu’il voyait, et imagina tout ce qu’il ne voyait point. Il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues, et que les babouches de Zadig étaient bleues, que les rubans de sa femme étaient jaunes, et que le bonnet de Zadig était jaune ; c’étaient là de terribles indices pour un prince délicat. Les soupçons se tournèrent en certitude dans son esprit aigri.
Tous les esclaves des rois et des reines sont autant d’espions de leurs cœurs. On pénétra bientôt qu’Astarté était tendre, et que Moabdar était jaloux. L’envieux engagea l’envieuse à envoyer au roi sa jarretière, qui ressemblait à celle de la reine. Pour surcroît de malheur, cette jarretière était bleue. Le monarque ne songea plus qu’à la manière de se venger. Il résolut une nuit d’empoisonner la reine, et de faire mourir Zadig par le corbeau au point du jour. L’ordre en fut donné à un impitoyable eunuque, exécuteur de ses vengeances. Il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était muet, mais qui n’était pas sourd. On le souffrait toujours : il était témoin de ce qui se passait de plus secret, comme un animal domestique. Ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig. Il entendit, avec autant de surprise que d’horreur, donner l’ordre de leur mort. Mais comment faire pour prévenir cet ordre effroyable qui allait s’exécuter dans peu d’heures ? Il ne savait pas écrire ; mais il avait appris à peindre, et savait surtout faire ressembler. Il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu’il voulait faire entendre à la reine. Son dessin représentait le roi agité de fureur, dans un coin du tableau, donnant des ordres à son eunuque ; un cordeau bleu et un vase sur une table, avec des jarretières bleues et des rubans jaunes ; la reine, dans le milieu du tableau, expirante entre les bras de ses femmes ; et Zadig étranglé à ses pieds. L’horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire aux premiers rayons de l’aurore. Dès qu’il eut fini cet ouvrage, il courut chez une femme d’Astarté, la réveilla, et lui fit entendre qu’il fallait dans l’instant même porter ce tableau à la reine.
Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper à la porte de Zadig ; on le réveille ; on lui donne un billet de la reine ; il doute si c’est un songe ; il ouvre la lettre d’une main tremblante. Quelle fut sa surprise, et qui pourrait exprimer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il lut ces paroles : « Fuyez, dans l’instant même, où l’on va vous arracher la vie ! Fuyez, Zadig ; je vous l’ordonne au nom de notre amour et de mes rubans jaunes. Je n’étais point coupable ; mais je sens que je vais mourir criminelle. »
Zadig eut à peine la force de parler. Il ordonna qu’on fît venir Cador ; et, sans lui rien dire, il lui donna ce billet. Cador le força d’obéir, et de prendre sur-le-champ la route de Memphis. « Si vous osez aller trouver la reine, lui dit-il, vous hâtez sa mort ; si vous parlez au roi, vous la perdez encore. Je me charge de sa destinée ; suivez la vôtre. Je répandrai le bruit que vous avez pris la route des Indes. Je viendrai bientôt vous trouver, et je vous apprendrai ce qui se sera passé à Babylone. »
Cador, dans le moment même, fit placer deux dromadaires des plus légers à la course vers une porte secrète du palais ; il y fit monter Zadig, qu’il fallut porter, et qui était près de rendre l’âme. Un seul domestique l’accompagna ; et bientôt Cador, plongé dans l’étonnement et dans la douleur, perdit son ami de vue.
Cet illustre fugitif, arrivé sur le bord d’une colline dont on voyait Babylone, tourna la vue sur le palais de la reine, et s’évanouit ; il ne reprit ses sens que pour verser des larmes et pour souhaiter la mort. Enfin, après s’être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde, il fit un moment de retour sur lui-même, et s’écria : « Qu’est-ce donc que la vie humaine ? O vertu ! à quoi m’aviez-vous servi ? Deux femmes m’ont indignement trompé ; la troisième, qui n’est point coupable, et qui est plus belle que les autres, va mourir : Tout ce que j’ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédictions, et je n’ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l’infortune. Si j’eusse été méchant comme tant d’autres, je serais heureux comme eux. » Accablé de ces réflexions funestes, les yeux chargés du voile de la douleur, la pâleur de la mort sur le visage, et l’âme abîmée dans l’excès d’un sombre désespoir, il continuait son voyage vers l’Egypte.

LA FEMME BATTUE
Zadig dirigeait sa route sur les étoiles. La constellation d’Orion et le brillant astre de Sirius le guidaient vers le pôle de Canope. Il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux, tandis que la terre, qui n’est en effet qu’un point imperceptible dans la nature, paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble. Il se figurait alors les hommes tels qu’ils sont en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Cette image vraie semblait anéantir ses malheurs, en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone. Son âme s’élançait jusque dans l’infini, et contemplait, détachées de ses sens, l’ordre immuable de l’univers. Mais lorsque ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans son cœur, il pensait qu’Astarté était peut-être morte pour lui, l’univers disparaissait à ses yeux, et il ne voyait dans la nature entière qu’Astarté mourante et Zadig infortuné.
Comme il se livrait à ce flux et à ce reflux de philosophie sublime et de douleur accablante, il avançait vers les frontières de l’Egypte ; et déjà son domestique fidèle était dans la première bourgade, où il lui cherchait un logement. Zadig cependant se promenait vers les jardins qui bordaient ce village. Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours, et un homme furieux qui la suivait. Elle était déjà atteinte par lui, elle embrassait ses genoux. Cet homme l’accablait de coups et de reproches. Il jugea, à la violence de l’Egyptien et aux pardons réitérés que lui demandait la dame, que l’un était un jaloux, et l’autre une infidèle ; mais quand il eut considéré cette femme, qui était d’une beauté touchante, et qui même ressemblait un peu à la malheureuse Astarté, il se sentit pénétré de compassion pour elle, et d’horreur pour l’Egyptien.
« Secourez-moi, s’écria-t-elle à Zadig avec des sanglots ; tirez-moi des mains du plus barbare des hommes, sauvez-moi la vie ! »
A ces cris, Zadig courut se jeter entre elle et ce barbare. Il avait quelque connaissance de la langue égyptienne. Il lui dit en cette langue : « Si vous avez quelque humanité, je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse. Pouvez-vous outrager ainsi un chef-d’œuvre de la nature, qui est à vos pieds, et qui n’a pour sa défense que des larmes ? – Ah ! Ah ! lui dit cet emporté, tu l’aimes donc aussi ! Et c’est de toi qu’il faut que je me venge. » En disant ces paroles, il laisse la dame, qu’il tenait d’une main par les cheveux, et, prenant sa lance, il veut en percer l’étranger. Celui-ci, qui était de sang-froid, évita aisément le coup d’un furieux. Il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée. L’un veut la retirer, l’autre l’arracher. Elle se brise entre leurs mains. L’Egyptien tire son épée ; Zadig s’arme de la sienne. Ils s’attaquent l’un l’autre. Celui-ci porte cent coups précipités ; celui-là les pare avec adresse. La dame, assise sur un gazon, rajuste sa coiffure et les regarde. L’Egyptien était plus robuste que son adversaire. Zadig était plus adroit. Celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras, et celui-là comme un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard. Zadig passe à lui, et le désarme ; et tandis que l’Egyptien, devenu plus furieux, veut se jeter sur lui, il le saisit, le presse, le fait tomber en lui tenant l’épée sur la poitrine ; il lui offre de lui donner la vie. L’Egyptien, hors de lui, tire son poignard ; il en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait. Zadig, indigné, lui plonge son épée dans le sein. L’Egyptien jette un cri horrible, et meurt en se débattant. Zadig alors s’avança vers la dame, et lui dit d’une voix soumise : « Il m’a forcé de le tuer : je vous ai vengée ; vous être délivrée de l’homme le plus violent que j’aie jamais vu. Que voulez-vous maintenant de moi, madame ? – Que tu meures, scélérat, lui répondit-elle ; que tu meures ! Tu as tué mon amant ; je voudrais pouvoir déchirer ton cœur. – En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit Zadig ; il vous battait de toutes ses forces et il voulait m’arracher la vie parce que vous m’avez conjuré de vous secourir. – Je voudrais qu’il me battît, et que tu fusses à sa place ! » Zadig, plus surpris et plus en colère qu’il ne l’avait été de sa vie, lui dit : « Madame, toute belle que vous êtes, vous mériteriez que je vous battisse à mon tour, tant vous êtes extravagante ; mais je n’en prendrai pas la peine. Là-dessus il remonta sur son chameau, et avança vers le bourg. A peine avait-il fait quelques pas qu’il se retourne au bruit que faisaient quatre courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride. L’un deux, en voyant cette femme, s’écria : « C’est elle-même ! Elle ressemble au portrait qu’on nous en a fait. » Ils ne s’embarrassèrent pas du mort, et se saisirent incontinent de la dame. Elle ne cessait de crier à Zadig : « Secourez-moi, et je suis à vous jusqu’au tombeau ! » L’envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle. « A d’autres : répondit-il ; vous ne m’y attraperez plus. »
D’ailleurs il était blessé, son sang coulait, il avait besoin de secours ; et la vue des quatre Babyloniens, probablement envoyés par le roi Moabdar, le remplissait d’inquiétude. Il s’avance en hâte vers le village, n’imaginant pas pourquoi quatre courriers de Babylone venaient prendre cette Egyptienne, mais encore plus étonné du caractère de cette dame.
Comme il entrait dans la bourgade égyptienne, il se vit entouré par le peuple. Chacun criait : « Voilà celui qui a enlevé la belle Missouf, et qui vient d’assassiner Clétofis ! – Messieurs, dit-il, Dieu me préserve d’enlever jamais votre belle Missouf ! Elle est trop capricieuse ; et, à l’égard de Clétofis, je ne l’ai point assassiné ; je me suis défendu seulement contre lui. Il voulait me tuer, parce que je lui avais demandé très humblement grâce pour la belle Missouf, qu’il battait impitoyablement. Je suis un étranger qui vient chercher un asile dans l’Egypte ; et il n’y a pas d’apparence qu’en venant demander votre protection j’aie commencé par enlever une femme, et par assassiner un homme. »
Les Egyptiens étaient alors justes et humains. Le peuple conduisit Zadig à la maison de ville. On commença par le faire panser de sa blessure, et ensuite on l’interrogea, lui et son domestique séparément, pour savoir la vérité. On reconnut que Zadig n’était point un assassin ; mais il était coupable du sang d’un homme : la loi le condamnait à être esclave. On vendit au profit de la bourgade ses deux chameaux ; on distribua aux habitants tout l’or qu’il avait apporté ; sa personne fut exposée en vente dans la place publique, ainsi que celle de son compagnon de voyage. Un marchand arabe, nommé Sétoc, y mit l’enchère ; mais le valet plus propre à la fatigue, fut vendu bien plus chèrement que le maître. On ne faisait pas de comparaison entre ces deux hommes. Zadig fut donc esclave subordonné à son valet : on les attacha ensemble avec une chaîne qu’on leur passa aux pieds, et en cet état ils suivirent le marchand arabe dans sa maison. Zadig, en chemin, consolait son domestique, et l’exhortait à la patience ; mais, selon sa coutume, il faisait des réflexions sur la vie humaine. « Je vois, lui disait-il, que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne. Tout m’a tourné jusqu’ici d’une façon bien étrange. J’ai été condamné à l’amende pour avoir vu passer une chienne ; j’ai pensé être empalé pour un griffon ; j’ai été envoyé au supplice parce que j’avais fait des vers à la louange du roi ; j’ai été sur le point d’être étranglé parce que la reine avait des rubans jaunes, et me voici esclave avec toi parce qu’un brutal a battu sa maîtresse. Allons, ne perdons point courage ; tout ceci finira peut-être ; il faut bien que les marchands arabes aient des esclaves ; et pourquoi ne le serais-je pas comme un autre, puisque je suis un homme comme un autre ? Ce marchand ne sera pas impitoyable ; il faut qu’il traite bien ses esclaves, s’il en veut tirer des services. » Il parlait ainsi, et dans le fond de son cœur il était occupé du sort de la reine de Babylone.
Sétoc, le marchand, partir deux jours après pour l’Arabie déserte avec ses esclaves et ses chameaux ; et toutes les petites distinctions furent pour lui.
Un chameau mourut à deux journées d’Horeb : on répartit sa charge sur le dos de chacun des serviteurs ; Zadig en eut sa part. Sétoc se mit à rire en voyant tous ses esclaves marcher courbés. Zadig prit la liberté de lui en expliquer la raison, et lui apprit les lois de l’équilibre. ; le marchand, étonné, commença à le regarder d’un autre œil. Zadig, voyant qu’il avait excité sa curiosité, la redoubla en lui apprenant beaucoup de choses qui n’étaient point étrangères à son commerce ; les pesanteurs spécifiques des métaux et des denrées sous un volume égal ; les propriétés de plusieurs animaux utiles ; le moyen de rendre tels ceux qui ne l’étaient pas ; enfin, il lui parut un sage. Sétoc lui donna la préférence sur son camarade, qu’il avait tant estimé. Il le traita bien, et n’eut pas sujet de s’en repentir.
Arrivé dans sa tribu, Sétoc commença par redemander cinq cents onces d’argent à un Hébreu auquel il les avait prêtées en présence de deux témoins ; mais ces deux témoins étaient morts, et l’Hébreu, ne pouvant être convaincu, s’appropriait l’argent du marchand, en remerciant Dieu de ce qu’il lui avait donné le moyen de tromper un Arabe. Sétoc confia sa peine à Zadig, qui était devenu son conseil. « En quel endroit, demanda Zadig, prêtâtes-vous vos cinq cents onces à cet infidèle ? – Sur une large pierre, répondit le marchand, qui est auprès du mont Horeb. – Quel est le caractère de votre débiteur ? dit Zadig. – Celui d’un fripon, reprit Sétoc. – _Mais je vous demande si c’est un homme vif ou flegmatique, avisé ou imprudent. – C’est de tous les mauvais payeurs, dit Sétoc, le plus vif que je connaisse. – Eh bien ! insista Zadig, permettez que je plaide votre cause devant le juge. » En effet il cita l’Hébreu au tribunal, et il parla ainsi au juge : « Oreiller du trône d’équité, je viens redemander à cet homme, au nom de mon maître, cinq cents onces d’argent qu’il ne veut pas rendre. – Avez-vous des témoins ? dit le juge. – Non ? Ils sont morts ; mais il reste une large pierre sur laquelle l’argent fut compté ; et s’il plaît à votre Grandeur d’ordonner qu’on aille chercher la pierre, j’espère qu’elle portera témoignage ; nous resterons ici, l’Hébreu et moi, en attendant que la pierre vienne ; je l’enverrai chercher aux dépens de Sétoc, mon maître. – Très volontiers », répondit le juge ; et il se mit à expédier d’autres affaires.
A la fin de l’audience : « Eh bien ! dit-il à Zadig, votre pierre n’est pas encore venue ? » L’hébreu, en riant, répondit : « Votre Grandeur resterait ici jusqu’à demain que la pierre ne serait pas encore arrivée ; elle est à plus de six milles d’ici, et il faudrait quinze hommes pour la remuer. – Eh bien ! s’écria Zadig, je vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage ; puisque cet homme sait où elle est, il avoue donc que c’est sur elle que l’argent fut compté. » L’Hébreu, déconcerté, fut bientôt contraint de tout avouer. Le juge ordonna qu’il serait lié à la pierre, sans boire ni manger, jusqu’à ce qu’il eût rendu les cinq cents onces, qui furent bientôt payées.
L’esclave Zadig et la pierre furent en grande recommandation dans l’Arabie.

LE BUCHER
Sétoc, enchanté, fit de son esclave son ami intime. Il ne pouvait pas plus se passer de lui qu’avait fait le roi de Babylone ; et Zadig fut heureux que Sétoc n’eût point de femme. Il découvrait dans son maître un naturel porté au bien, beaucoup de droiture et de bon sens. Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée céleste ; c’est-à-dire le soleil, la lune, et les toiles, selon l’ancien usage d’Arabie. Il lui en parlait quelquefois avec beaucoup de discrétion. Enfin il lui dit que c’étaient des corps comme les autres, qui ne méritaient pas plus son hommage qu’un arbre ou un rocher. « Mais, disait Sétoc, ce sont des êtres éternels dont nous tirons tous nos avantages ; ils animent la nature ; ils règlent les saisons ; ils sont d’ailleurs si loin de nous qu’on ne peut pas s’empêcher de les révérer. – Vous recevrez plus d’avantages, répondit Zadig, des eaux de la mer Rouge, qui porte vos marchandises aux Indes ? Pourquoi ne serait-elle pas aussi ancienne que les étoiles ? Et si vous adorez ce qui est éloigné de vous, vous devez adorer la terre des Gangarides, qui est aux extrémités du monde. – Non, disait Sétoc, les étoiles sont trop brillantes pour que je ne les adore pas. » Le soir venu, Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait souper avec Sétoc ; et dès que son patron parut, il se jeta à genoux devant ces cires allumées, et leur dit : « Eternelles et brillantes clartés, soyez-moi toujours propices ! » Ayant proféré ces paroles, il se mit à table sans regarder Sétoc. « Que faites-vous donc ? lui dit Sétoc étonné. – Je fais comme vous, répondit Zadig ; j’adore ces chandelles, et je néglige leur maître et le mien. » Sétoc comprit le sens profond de cet apologue. La sagesse de son esclave entra dans son âme ; il ne prodigua plus son encens aux créatures, et adora l’Etre éternel qui les a faites.
Il y avait alors dans l’Arabie une coutume affreuse, venue originairement de Scythie, et qui, s’étant établie dans les Indes par le crédit des bracmanes, menaçait d’envahir tout l’Orient. Lorsqu’un homme marié était mort, et que sa femme bien-aimée voulait être sainte, elle se brûlait en public sur le corps de son mari. C’était une fête solennelle qui s’appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans laquelle il y avait eu le plus de femmes brûlées était la plus considérée. Un Arabe de la tribu de Sétoc étant mort, sa veuve, nommée Almona, qui était fort dévote, fit savoir le jour et l’heure où elle se jetterait dans le feu au son des tambours et des trompettes. Zadig remontra à Sétoc combien cette horrible coutume était contraire au bien du genre humain ; qu’on laissait brûler tous les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des enfants à l’Etat, ou du moins élever les leurs ; et il le fit convenir qu’il fallait, si on pouvait, abolir un usage si barbare. Sétoc répondit : « Il y a plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler. Qui de nous osera changer une loi que le temps a consacrée ? Y a-t-il rien de plus respectable qu’un ancien abus ? – La raison est plus ancienne, reprit Zadig. Parlez aux chefs des tribus, et je vais trouver la jeune veuve. »
Il se fit présenter à elle ; et après s’être insinué dans son esprit par des louanges sur sa beauté, après lui avoir dit combien c’était dommage de mettre au feu tant de charmes, il la loua encore sur sa constance et sur son courage. « Vous aimiez donc prodigieusement votre mari ? lui dit-il ? – Moi ? Point du tout, répondit la dame arabe. C’était un brutal, un jaloux, un homme insupportable ; mais je suis fermement résolue de me jeter sur son bûcher. – Il faut, dit Zadig, qu’il y ait apparemment un plaisir bien délicieux à être brûlée vive. – Ah ! Cela fait frémir la nature, dit la dame ; mais il faut en passer par là. Je suis dévote ; je serais perdue de réputation, et tout le monde se moquerait de moi si je ne me brûlais pas. » Zadig, l’ayant fait convenir qu’elle se brûlait pour les autres et par vanité, lui parla longtemps d’une manière à lui faire aimer un peu la vie, et parvint même à lui inspirer quelque bienveillance pour celui qui lui parlait. « Que feriez-vous enfin, lui dit-il, si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas ? – Hélas ! dit la dame, je crois que je vous prierais de m’épouser. »
Zadig était trop rempli de l’idée d’Astarté pour ne pas éluder cette déclaration ; mais il alla dans l’instant trouver les chefs des tribus, leur dit ce qui s’était passé, et leur conseilla de faire une loi par laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu’après avoir entretenu un jeune homme, tête à tête pendant une heure entière.
Depuis ce temps, aucune dame ne se brûla en Arabie. On eut au seul Zadig l’obligation d’avoir détruit en un jour une coutume si cruelle, qui durait depuis tant de siècles. Il était donc le bienfaiteur de l’Arabie.

LE SOUPER
Sétoc, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Balzora, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d’hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l’univers était une grande famille qui se rassemblait à Balzora. Il se trouva à table, dès le second jour, avec un égyptien, un Indien gangaride, un habitant du Cathay, un Grec, un Celte, et plusieurs autres étrangers qui, dans leurs fréquents voyages vers le golfe Arabique, avaient appris assez d’arabe pour se faire entendre. L’égyptien paraissait fort en colère. « Quel abominable pays que Balzora ! disait-il, l’on m’y refuse mille onces d’or sur le meilleur effet du monde. – Comment donc, dit Sétoc ; sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme ? – Sur le corps de ma tante, répondit l’Egyptien ; c’était la plus brave femme de l’Egypte. Elle m’accompagnait toujours ; elle est morte en chemin : j’en ai fait une des plus belles momies que nous ayons ; et je trouverais dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage. Il est bien étrange qu’on ne veuille pas seulement me donner ici mille onces d’or sur un effet si solide. » Tout en se courrouçant, il était près de manger d’une excellent poule bouillie, quand l’Indien, le prenant par la main, s’écria avec douleur : « Ah ! Qu’allez-vous faire ? – Manger de cette poule, dit l’homme à la momie. – Gardez-vous-en bien, dit le Gangaride ; il se pourrait faire que l’âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudrez pas vous exposer à manger votre tante. Faire cuire des poules, c’est outrager manifestement la nature. – Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules ? reprit le colérique Egyptien ; nous adorons un bœuf, et nous en mangeons bien. – Vous adorez un bœuf ! Est-il possible ? dit l’homme du Gange. – Il n’y a rien de si possible, repartit l’autre ; il y a cent trente-cinq mille ans ! dit l’Indien, ce compte est un peu exagéré ; il n’y en a que quatre-vingt mille que l’Inde est peuplée, et assurément nous sommes vos anciens, et Brama nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les autels et à la broche. – Voilà un plaisant animal que votre Brama, pour le comparer à Apis ! dit l’Egyptien ; qu’a donc fait votre Brama de si beau ? » Le bramin répondit : « C’est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui toute la terre doit le jeu des échecs. – Vous vous trompez, dit un Chaldéen qui était auprès de lui ; c’est le poisson Oannès à qui on doit de si grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu’à lui ses hommages. Tout le monde vous dira que c’était un être divin, qu’il avait la queue dorée, avec une belle tête d’homme, et qu’il sortait de l’eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour. Il eut plusieurs enfants qui durent rois, comme chacun sait. J’ai son portrait chez moi, que je révère comme je le dois. On peut manger du bœuf tant qu’on veut ; mais c’est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson ; d’ailleurs vous êtes tous deux d’une origine trop peu noble et trop récente pour ne rien disputer. La nation égyptienne ne compte que cent trente-cinq mille ans, et les Indiens ne se vantent que de quatre-vingt mille, tandis que nous avons des almanachs de quatre mille siècles. Croyez-moi, renoncez à vos folies, et je vous donnerai à chacun un beau portrait d’Oannès. »
L’homme de Cambalu, prenant la parole, dit : « Je respecte fort les Egyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Celtes, Brama, le bœuf Apis, le beau poisson Oannès ; mais peut-être que le Li ou le Tien (1), comme on voudra l’appeler, vaut bien les bœufs et les poissons. Je ne dirait rien de mon pays ; il est aussi grand que la terre d’Egypte, la Chaldée et les Indes ensemble. Je ne dispute pas d’antiquité, parce qu’il suffit d’être heureux, et que c’est fort peu de chose d’être ancien ; mais, s’il fallait parler d’almanachs, je dirais que toute l’Asie prend les nôtres, et que nous en avions de fort bons avant qu’on sût l’arithmétique en Chalée.
– Vous êtes de grands ignorants tous tant que vous êtes ! s’écria le Grec ; est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout, et que la forme et la matière ont mis le monde dans l’état où il est ? » Ce Grec parla longtemps mais il fut enfin interrompu par le Celte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu’on disputait, se crut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu’il n’y avait que Teutath et le guy de chêne qui valussent la peine qu’on en parlât ; que, pour lui, il avait toujours du guy dans sa poche ; que les Scythes, ses ancêtres, étaient les seules gens de bien qui eussent jamais été au monde ; qu’ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes, mais que cela n’empêchait pas qu’on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation ; et qu’enfin, si quelqu’un parlait mal de Teutath, il lui apprendrait à vivre. La querelle s’échauffa pour lors, et Sétoc vit le moment où la table allait être ensanglantée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin : il s’adressa d’abord au Celte, comme au plus furieux ; il lui dit qu’il avait raison, et lui demanda du guy ; il loua le Grec sur son éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de chose à l’homme du Cathay, parce qu’il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite il leur dit : « Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien, car vous êtes tous du même avis. » A ce mot, ils se récrièrent tous. « N’est-il par vrai, dit-il au Celte, que vous n’adorez pas ce guy, mais celui qui a fait le guy et le chêne ? – Assurément, répondit le Celte. – Et vous, monsieur l’Egyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs ? – Oui, dit l’Egyptien. – Le poisson Oannès, continua-t-il, doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. – D’accord, dit le Chaldéen. – L’Indien, ajouta-t-il, et le Cathayen, reconnaissent comme vous un premier principe ; je n’ai pas trop bien compris les choses admirables que le Grec a dites, mais je suis sûr qu’il admet aussi un Etre supérieur, de qui la forme et la matière dépendent. » Le Grec, qu’on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. « Vous êtes donc tous de même avis, répliqué Zadig, et il n’y a pas là de quoi se quereller. » Tout le monde l’embrassé. Sétoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig apprit en arrivant qu’on lui avait fait son procès en son absence, et qu’il allait être brûlé à petit feu.
1 – Mots chinois qui signifient proprement : Li, la lumière naturelle, la raison ; et Tien, le ciel ; et qui signifient aussi Dieu. (Note de Voltaire)

LE RENDEZ-VOUS
Pendant son voyage à Balzora, les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir. Les pierreries et les ornements des jeunes veuves qu’ils envoyaient au bûcher leur appartenaient de droit ; c’était bien le moins qu’ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu’il leur avait joué. Ils accusèrent donc Zadig d’avoir des sentiments erronés sur l’armée céleste ; ils déposèrent contre lui, et jurèrent qu’ils lui avaient entendu dire que les étoiles ne se couchaient pas dans la mer. Ce blasphème effroyable fit frémir les juges ; ils furent prêt de déchirer leurs vêtements, quand ils ouïrent ces paroles impies, et ils l’auraient fait, sans doute, si Zadig avait eu de quoi les payer. Mais, dans l’excès de leur douleur, ils se contentèrent de le condamner à être brûlé à petit feu. Sétoc, désespéré, employa en vain son crédit pour sauver son ami ; il fut bientôt obligé de se taire. La jeune veuve Almona, qui avait pris beaucoup de goût à la vie, et qui en avait l’obligation à Zadig, résolut de le tirer du bûcher, dont il lui avait fait connaître l’abus. Elle roula son dessein dans sa tête, sans en parler à personne. Zadig devait être exécuté le lendemain ; elle n’avait que la nuit pour le sauver : voici comme elle s’y prit en femme charitable et prudente.
Elle se parfuma ; elle releva sa beauté par l’ajustement le plus riche et le plus galant, et alla demander une audience secrète au chef des prêtres des étoiles. Quand elle fut devant ce vieillard vénérable, elle lui parla en ces termes : « Fils aîné de la grande Ourse, frère du Taureau, cousin du grand Chien (c’étaient les titres de ce pontife), je viens vous confier mes scrupules. J’ai bien peur d’avoir commis un péché énorme en ne me brûlant pas dans le bûcher de mon cher mari. En effet, qu’avais-je à conserver ? Une chair périssable, et qui est déjà toute flétrie. » En disant ces paroles, elle tira de ses longues manches de soie ses bras nus, d’une forme admirable et d’une blancheur éblouissante. « Vous voyez, dit-elle, le peu que cela vaut ». Le pontife trouva dans son cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent, et sa bouche le confirma : il jura qu’il n’avait vu de sa vie de si beaux bras. « Hélas ! lui dit la veuve, les bras peuvent être un peu moins mal que le reste ; mais vous m’avouerez que la gorge n’est pas digne de mes attentions. » Alors elle laissa voir le sein le plus charmant que la nature eût jamais formé. Un bouton de rose sur une pomme d’ivoire n’eût paru auprès que de la garance sur du buis, et les agneaux sortant du lavoir auraient semblé d’un jaune brun. Cette gorge, ses grands yeux noirs qui languissaient en brillant doucement d’un feu tendre, ses joues animées de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le plus pur ; son nez, qui n’était pas comme la tour du mont Liban ; ses lèvres, qui étaient comme deux bordures de corail renfermant les plus belles perles de la mer d’Arabie, tout cela ensemble fit croire au vieillard qu’il avait vingt ans. Il fit en bégayant une déclaration tendre. Almona, le voyant enflammé, lui demanda la grâce de Zadig. « Hélas ! dit-il, ma belle dame, quand je vous accorderais sa grâce, mon indulgence ne servirait à rien ; il faut qu’elle soit signée de trois autres de mes confrères. – Signez toujours, dit Almona. – Volontiers, dit le prêtre, à condition que vos faveurs seront le prix de ma facilité. – Vous me faites trop d’honneur, dit Almona ; ayez seulement pour agréable de venir dans ma chambre après que le soleil sera couché, et dès que la brillante étoile Sheat sera sur l’horizon, vous me trouverez sur un sofa couleur de rose, et vous en userez comme vous pourrez avec votre servante. » Elle sortit alors, emportant avec elle la signature, et laissa le vieillard plein d’amour et de défiance de ses forces. Il employa le reste du jour à se baigner ; il but une liqueur composée de la cannelle de Ceylan, et des précieuses épices de Tidor et de Ternate ? et attendit avec impatience que l’étoile Sheat vînt à paraître.
Cependant la belle Almona alla trouver le second pontife. Celui-ci l’assura que le soleil, la lune, et tous les feux du firmament, n’étaient que des feux follets en comparaison de ses charmes ; Elle lui demanda la même grâce, et on lui proposa d’en donner le prix. Elle se laissa vaincre, et donna rendez-vous au second pontife au lever de l’étoile Algénib. De là elle passa chez le troisième et chez le quatrième prêtre, prenant toujours une signature, et donnant un rendez-vous d’étoile en étoile. Alors elle fit avertir les juges de venir chez elle pour une affaire importante. Ils s’y rendirent : elle leur montra les quatre noms, et leur dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de Zadig. Chacun d’eux arriva à l’heure prescrite ; chacun fut bien étonné d’y trouver ses confrères, et plus encore d’y trouver les juges, devant qui leur honte fut manifestée. Zadig fut sauvé. Sétoc fut si charmé de l’habileté d’Almona, qu’il en fit sa femme.
Zadig partit après s’être jeté aux pieds de sa belle libératrice. Sétoc et lui se quittèrent en pleurant, en se jurant une amitié éternelle, et en se promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune en ferait part à l’autre.
Zadig marcha du côté de la Syrie, toujours pensant à la malheureuse Astarté, et toujours réfléchissant sur le sort qui s’obstinait à se jouer de lui et à le persécuter. « Quoi ! disait-il, quatre cents onces d’or pour avoir vu passer une chienne ! Condamné à être décapité pour quatre mauvais vers à la louange du roi ! Prêt à être étranglé parce que la reine avait des babouches de la couleur de mon bonnet ! Réduit en esclavage pour avoir secouru une femme qu’on battait ; et sur le point d’être brûlé pour avoir sauvé la vie à toutes les jeunes veuves arabes ! »

LA DANSE
Sétoc devait aller, pour les affaires de son commerce, dans l’Ile de Serendib ; mais le premier mois de son mariage, qui est, comme on sait, la lune du miel, ne lui permettait ni de quitter sa femme, ni de croire qu’il pût jamais la quitter : il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage. « Hélas ! disait Zadig, faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi ? Mais il faut servir mes bienfaiteurs. » Il dit, il pleura, et il partit.
Il ne fut pas longtemps dans l’île de Serendib, sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l’arbitre de tous les différends entre les négociants, l’ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Le roi voulut le voir et l’entendre. Il connût bientôt tout ce que valait Zadig ; il eut confiance en sa sagesse, et en fit son ami. La familiarité et l’estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar. Je plais au roi, disait-il, ne serai-je pas perdu ? Cependant, il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté ; car il faut avouer que Nabussan, roi de Serendib, fils de Nussanab, fils de Nabassun, fils de Sanbusna, était un des meilleurs princes de l’Asie ; et quand on lui parlait, il était difficile de ne le pas aimer.
Ce bon prince était toujours loué, trompé et volé : c’était à qui pillerait ses trésors. Le receveur-général de l’île de Serenbid donnait toujours cet exemple fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait ; il avait changé de trésorier plusieurs fois ; mais il n’avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté, et la plus grosse aux administrateurs.
Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig. « Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous pas le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point ? – Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. » Le roi charmé lui demanda en l’embrassant, comment il fallait s’y prendre. – Il n’y a, dit Zadig, qu’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. – Vous vous moquez, dit le roi ; voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! Vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! – Je ne vous réponds pas qu’il sera le plus habile, repartit Zadig ; mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. »
Zadig parlait avec tant de confiance, que le roi crut qu’il avait quelque secret surnaturel pour connaître les financiers. – Je n’aime pas le surnaturel, dit Zadig ; les gens et les livres à prodige m’ont toujours déplu : si votre majesté veut me laisser faire l’épreuve que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. Nabussan, roi de Serendib, fut bien plus étonné d’entendre que ce secret était simple, que si on le lui avait donné pour un miracle : Or bien, dit-il, faites comme vous l’entendrez. « Laissez-moi faire, dit Zadig, vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. »
Le jour même il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l’emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan, fils de Nussanab, eussent à se rendre, en habits de soie légère, le premier de la lune du Crocodile, dans l’antichambre du roi. Ils s’y rendirent au nombre de soixante et quatre. On avait fait venir des violons dans un salon voisin ; tout était préparé pour le bal ; mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l’un après l’autre, par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, sa majesté ordonna qu’on les fît danser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce ; ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leurs côtés ? – Quels fripons ! disait tout bas Zadig. Un seul d’entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. – Ah ! L’honnête homme ! Le brave homme ! disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde ; car chacun, dans le temps qu’il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches, et pouvait à peine marcher.
Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante et trois filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la Tentation. On aurait en Perse empalé ces soixante et trois seigneurs ; en d’autres pays on eût fait une chambre de justice qui eût consommé en frais le triple de l’argent volé, et qui n’eût rien remis dans les coffres du souverain ; dans un autre royaume, ils se seraient pleinement justifiés, et auraient fait disgracier ce danseur si léger : à Serendib, ils ne furent condamnés qu’à augmenter le trésor public, car Nabussan était fort indulgent.
Il était aussi fort reconnaissant : il donna à Zadig une somme d’argent plus considérable qu’aucun trésorier n’en avait jamais volé au roi son maître. Zadig s’en servit pour envoyer des exprès à Babylone, qui devaient l’informer de la destinée d’Astarté. Sa voix trembla en donnant cet ordre, son sang reflua vers son cœur, ses yeux se couvrirent de ténèbres, son âme fut prête à l’abandonner. Le courrier partit, Zadig le vit embarquer ; il rentra chez le roi, ne voyant personne, croyant être dans sa chambre, et prononçant le mot d’amour. – Ah ! l’amour, dit le roi ; c’est précisément ce dont il s’agit, vous avez deviné ce qui fait ma peine. Que vous êtes un grand homme ! J’espère que vous m’apprendrez à connaître une femme à toute épreuve, comme vous m’avez fait trouver un trésorier désintéressé. Zadig, ayant repris ses sens, lui promit de le servir en amour comme en finance, quoique la chose parût plus difficile encore.